L’enquête met en avant l’existence de périodes d’engagement et désengagement. Par exemple, les professeurs de langues s’engagent certaines années dans des activités d’organisation de voyages puis s’en retirent. Ils allègent la pression pesant sur leur travail pendant un temps pour se réengager ensuite sur un nouveau projet. Mais les enseignants qui durent sont ceux qui trouvent des satisfactions dans le travail, par exemple quand ils conçoivent des situations pédagogiques et quand ils constatent qu’avec elles les élèves progressent. Les enseignants éprouvent de la satisfaction quand ils voient briller les yeux de leurs élèves. Le métier d’enseignant n’est plus un travail uniquement de transmission. C’est devenu un travail de conception de dispositif pédagogique, d’accompagnement et d’évaluation. Autre élément qui ressort de cette enquête : ceux qui ne s’usent pas sont aussi ceux qui mettent en adéquation leur engagement professionnel avec les valeurs pour lesquelles ils sont entrés dans l’enseignement. Quand les enseignants retrouvent ces valeurs dans le métier ça leur permet de tenir. Par exemple une affectation en CPGE peut être vécue positivement par des enseignants qui sont entrés dans le métier pour transmettre un haut niveau dans leur discipline. Ceux qui sont entrés dans le métier en défendant des valeurs émancipatrices de promotion sociale éprouvent une grande satisfaction à exercer avec des élèves issus de milieux populaires et qui accèdent à un diplôme universitaire en BTS.
Source : Que sait-on du travail des enseignants (2) : Comment les profs tiennent…


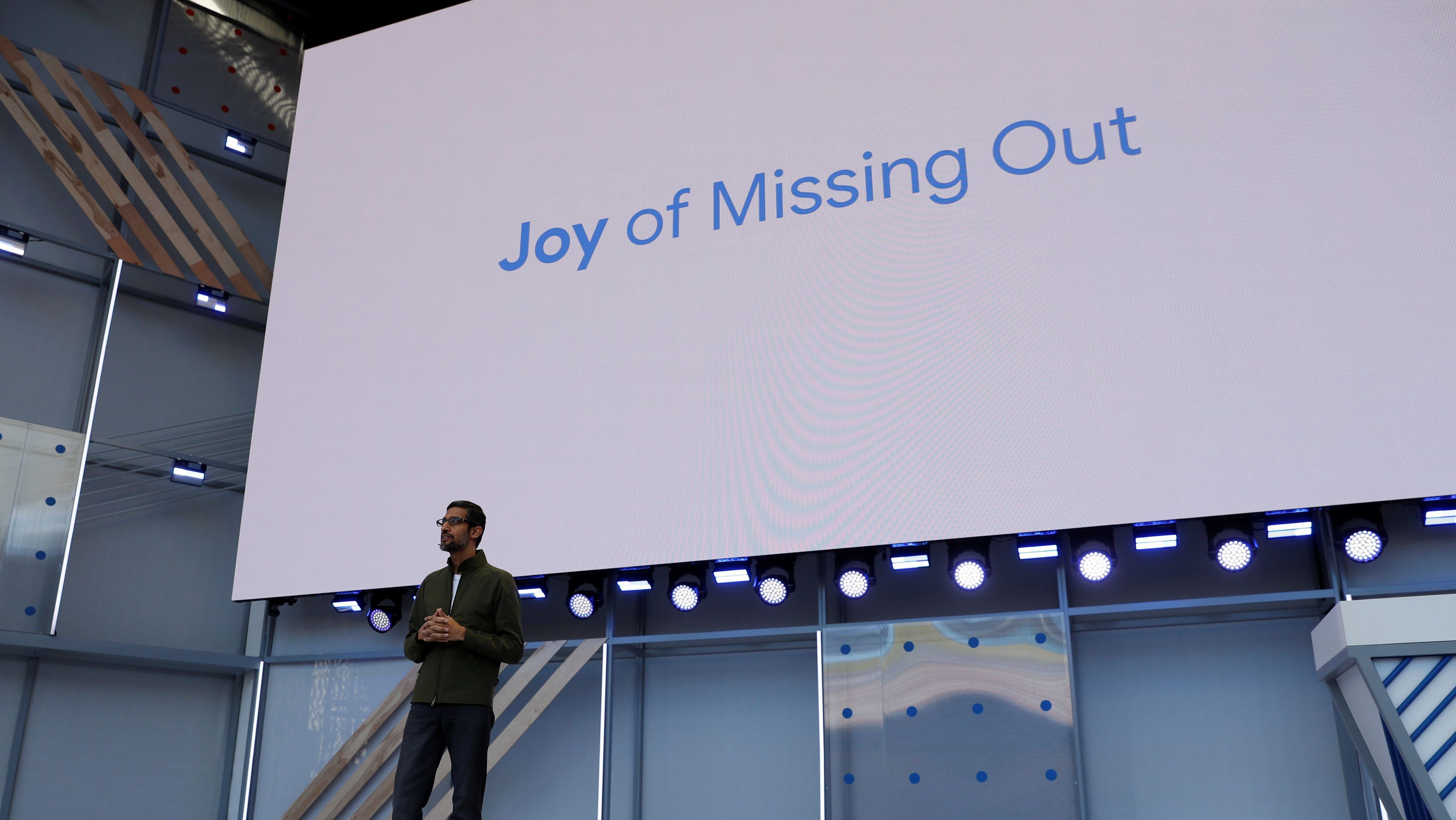

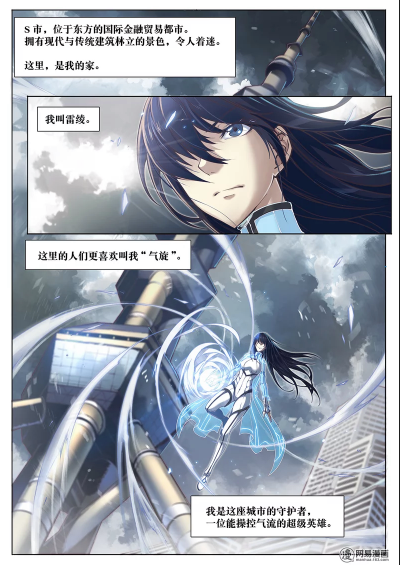












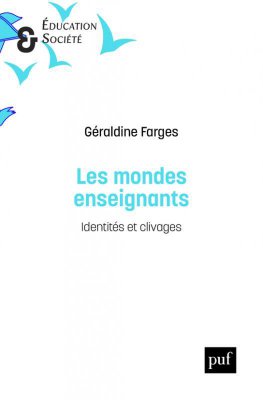 par exemple, le travail prescrit par l’administration scolaire est plus lourd que celui de leurs collègues entrés plus tôt dans le métier : ils déclarent un volume horaire moyen de 52 heures par semaine, soit 10 heures de plus que les autres enseignants (p.124). Conscients de sa dévalorisation dans l’espace social, les enseignants n’en continuent pas moins de valoriser leur métier.
par exemple, le travail prescrit par l’administration scolaire est plus lourd que celui de leurs collègues entrés plus tôt dans le métier : ils déclarent un volume horaire moyen de 52 heures par semaine, soit 10 heures de plus que les autres enseignants (p.124). Conscients de sa dévalorisation dans l’espace social, les enseignants n’en continuent pas moins de valoriser leur métier.

