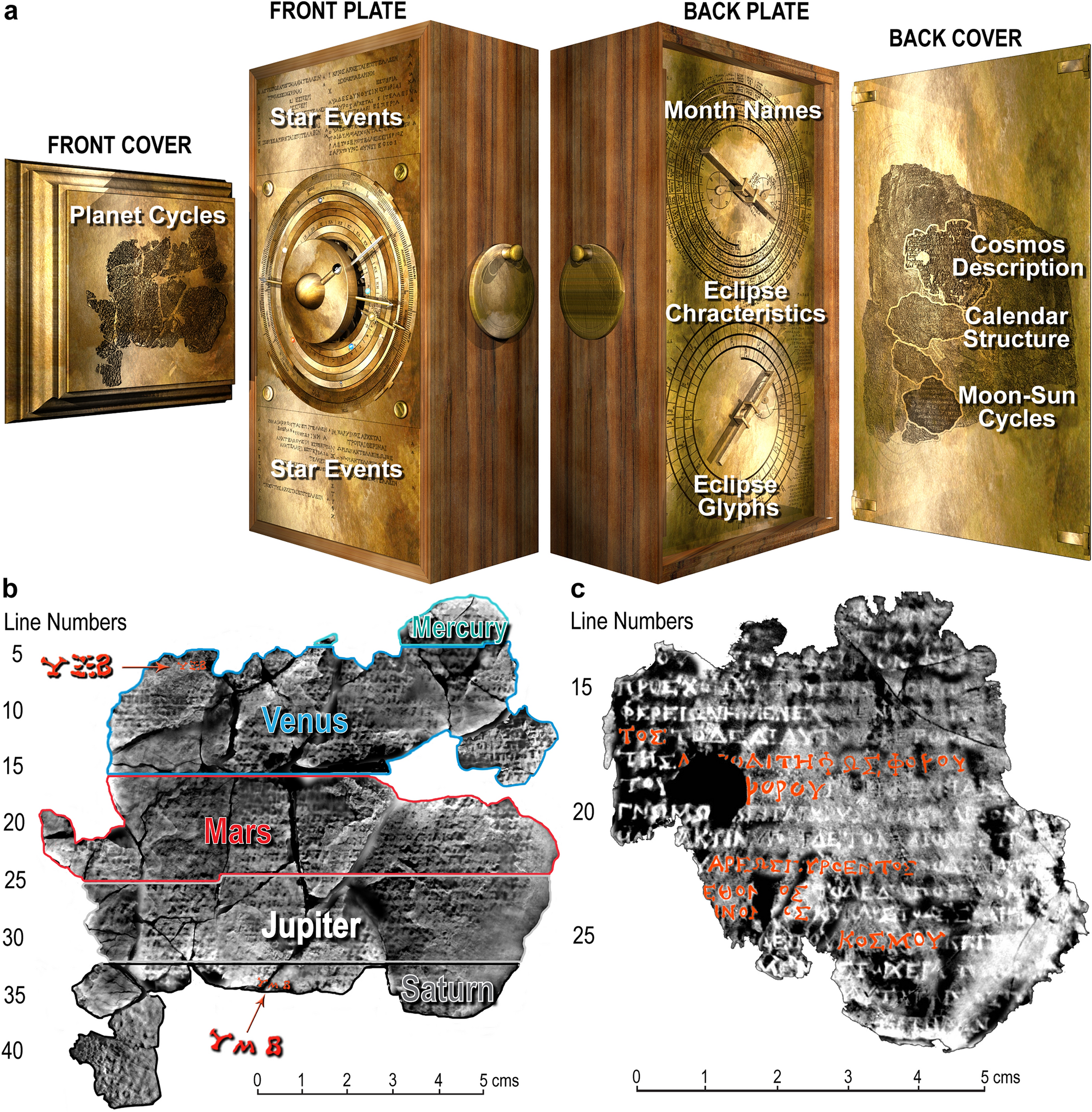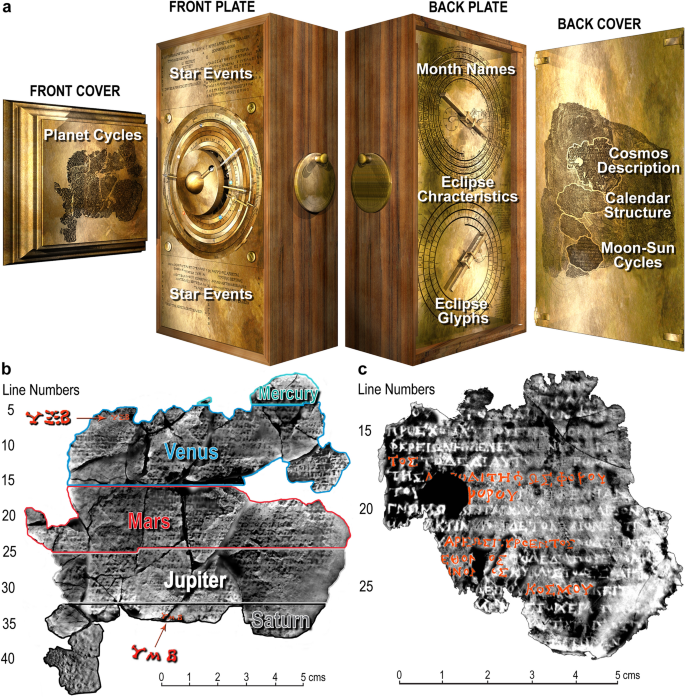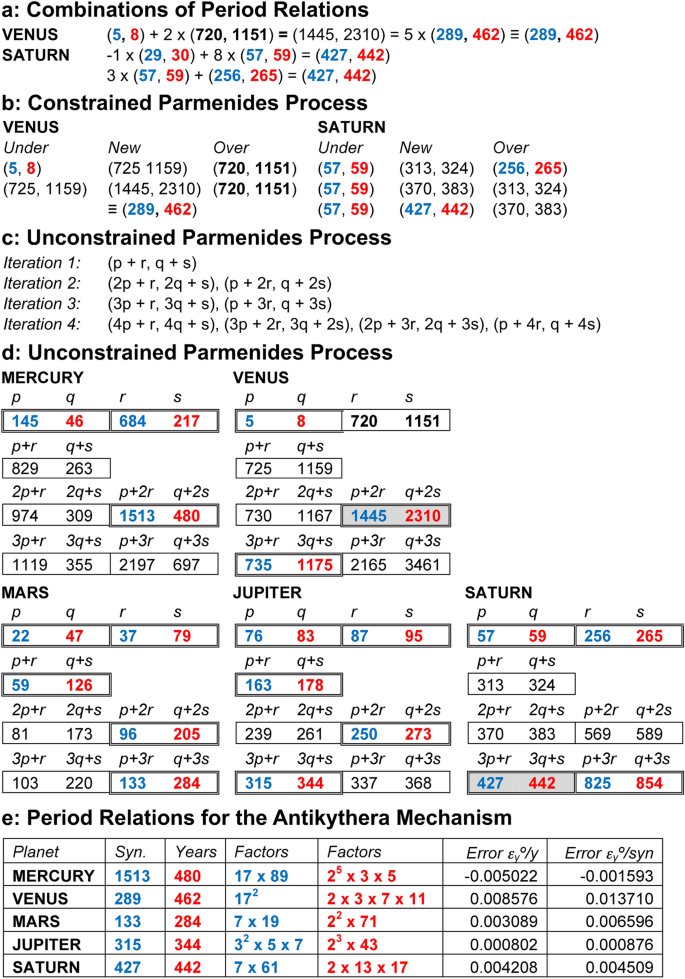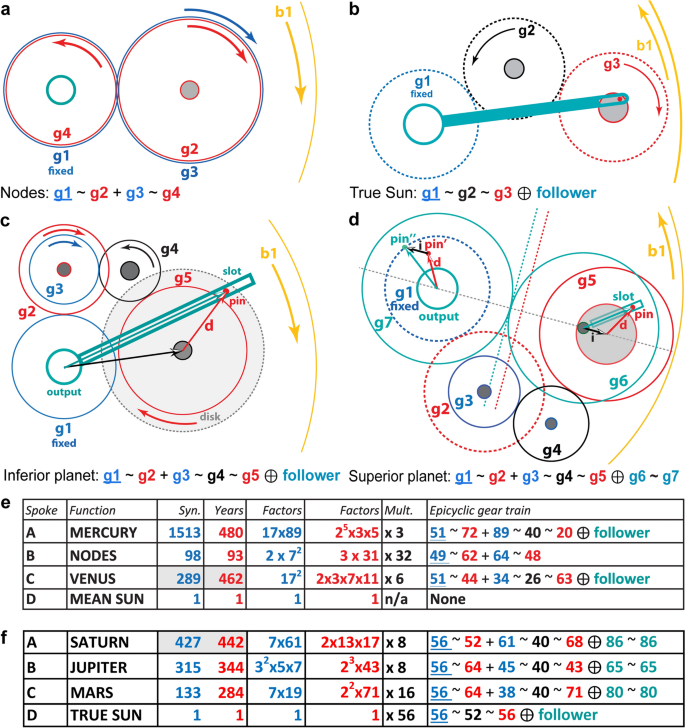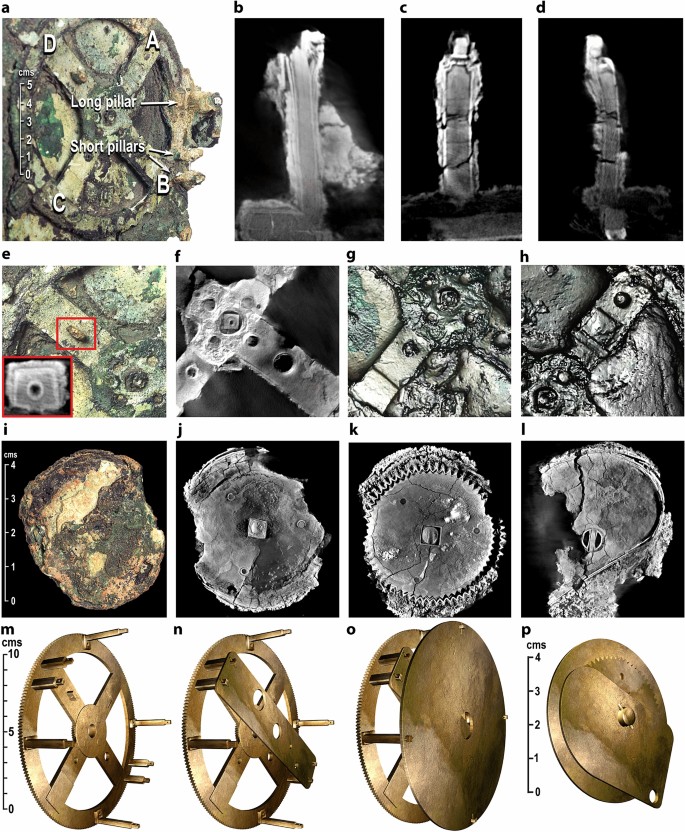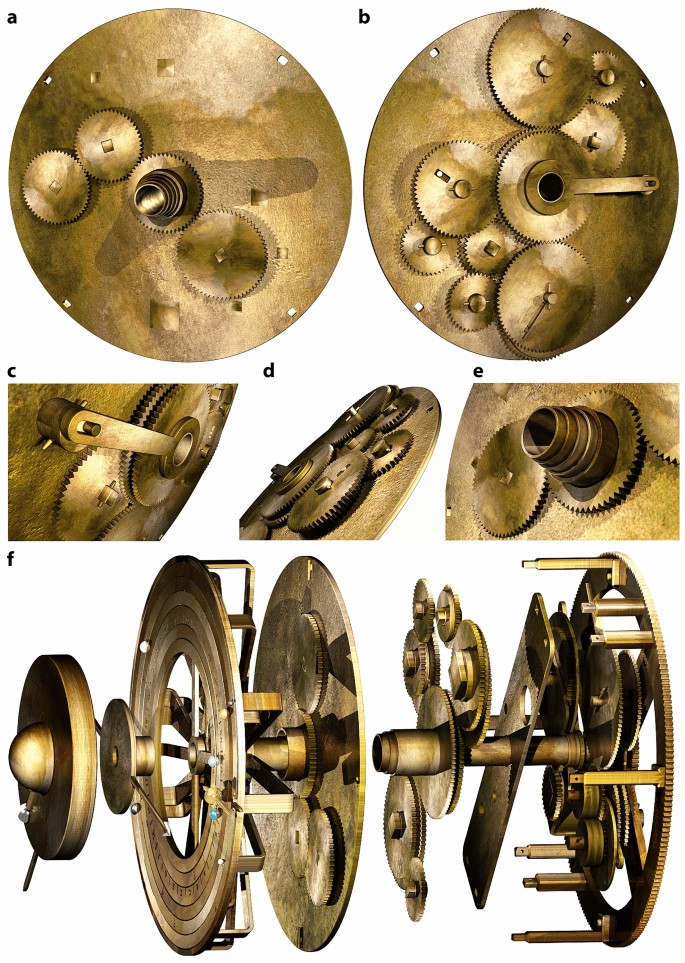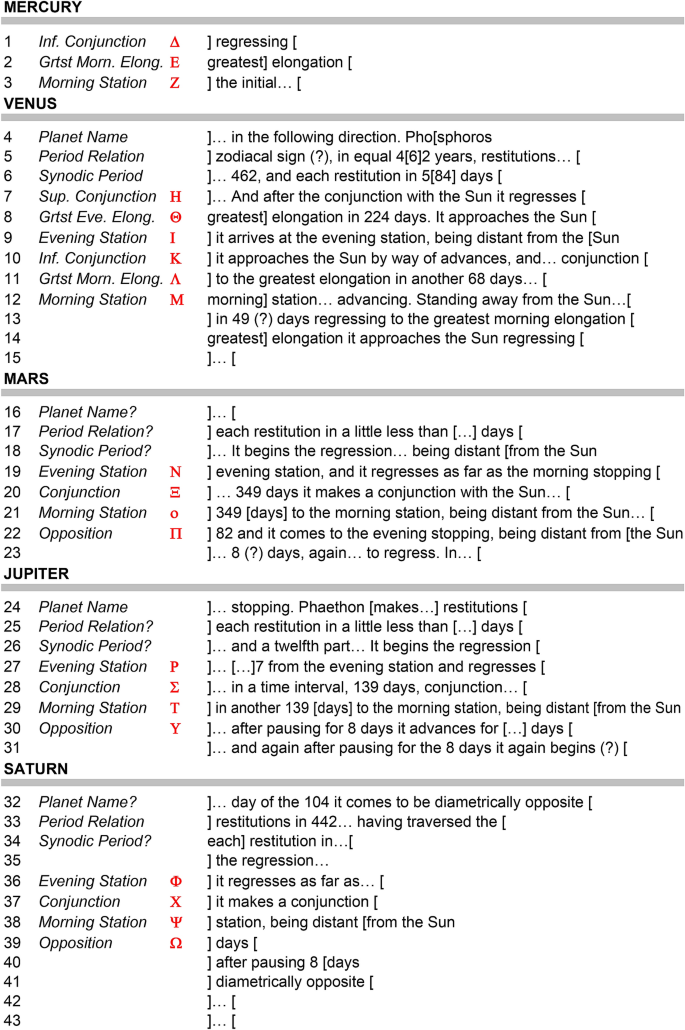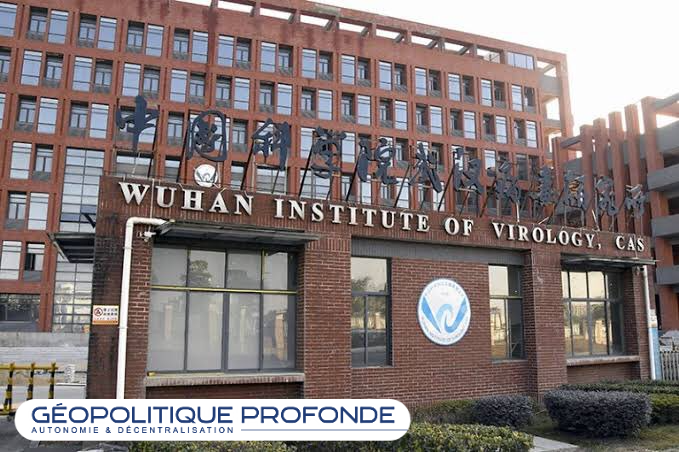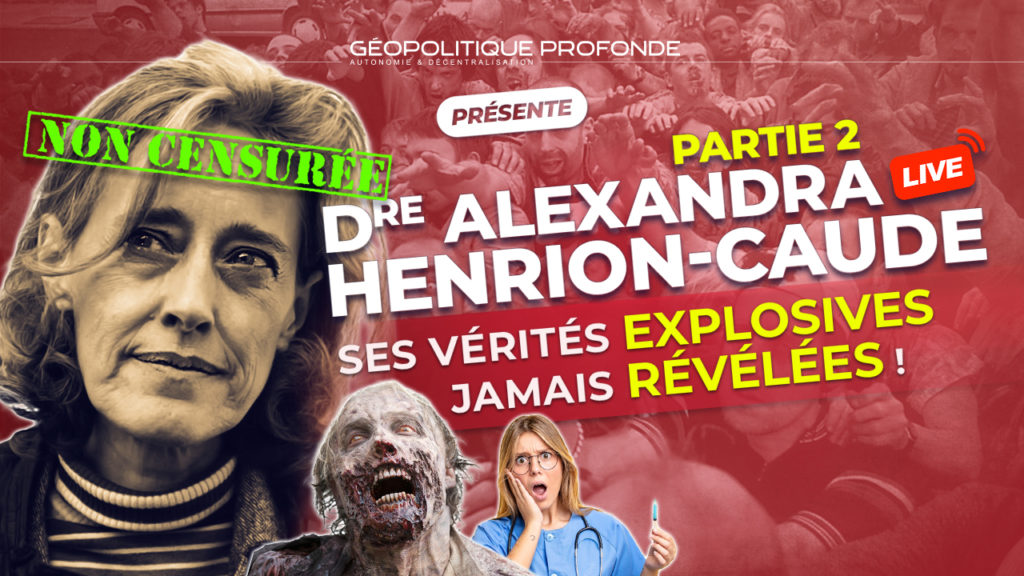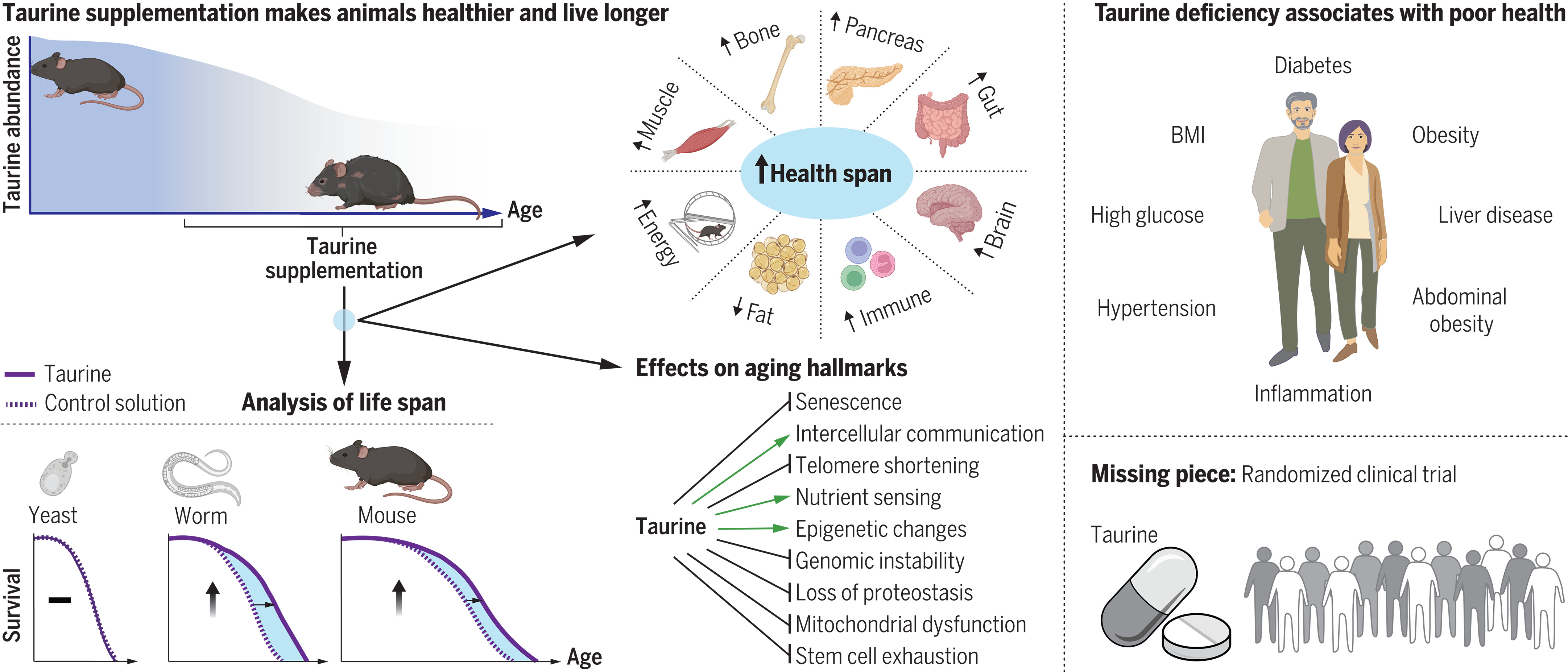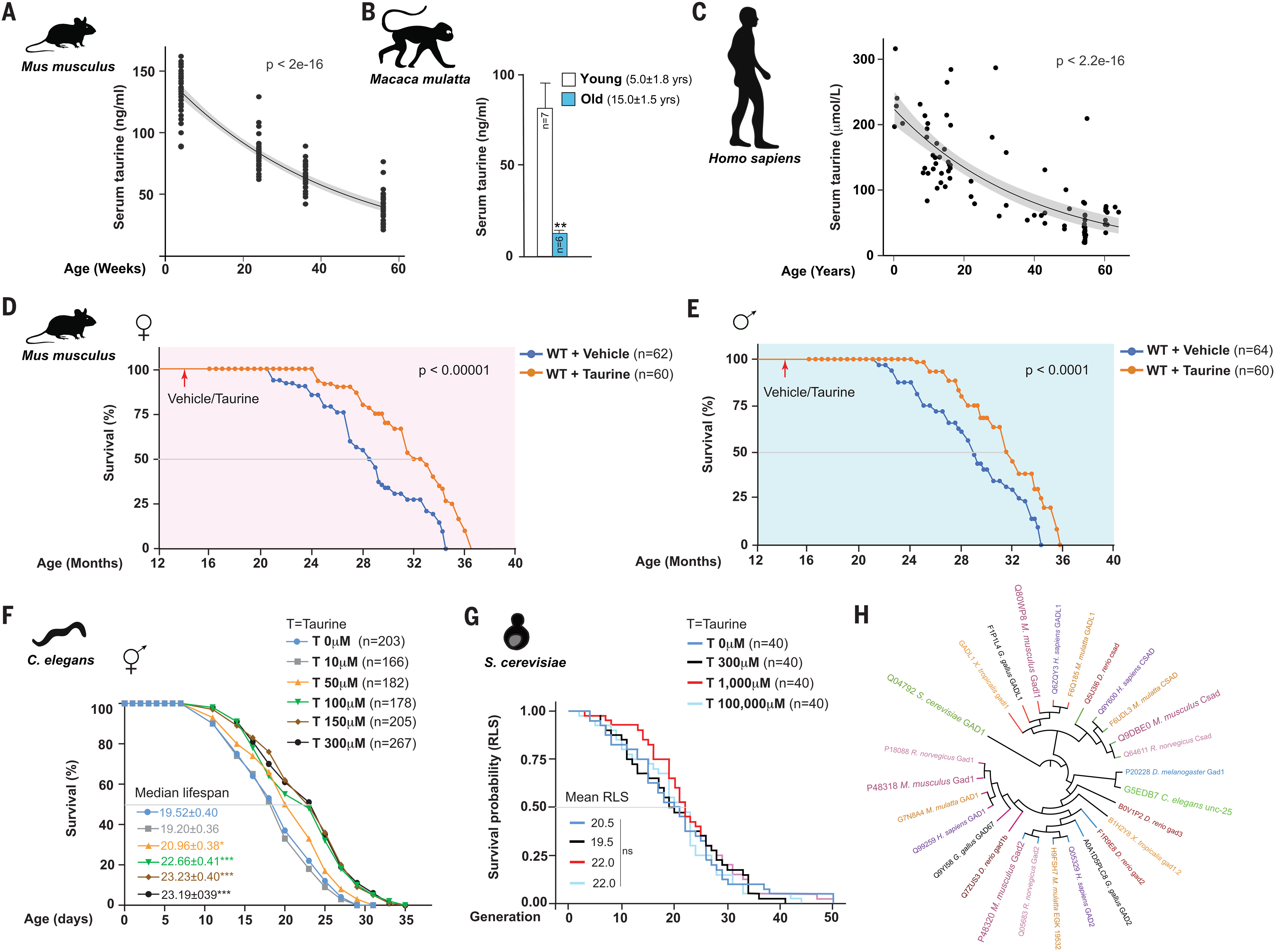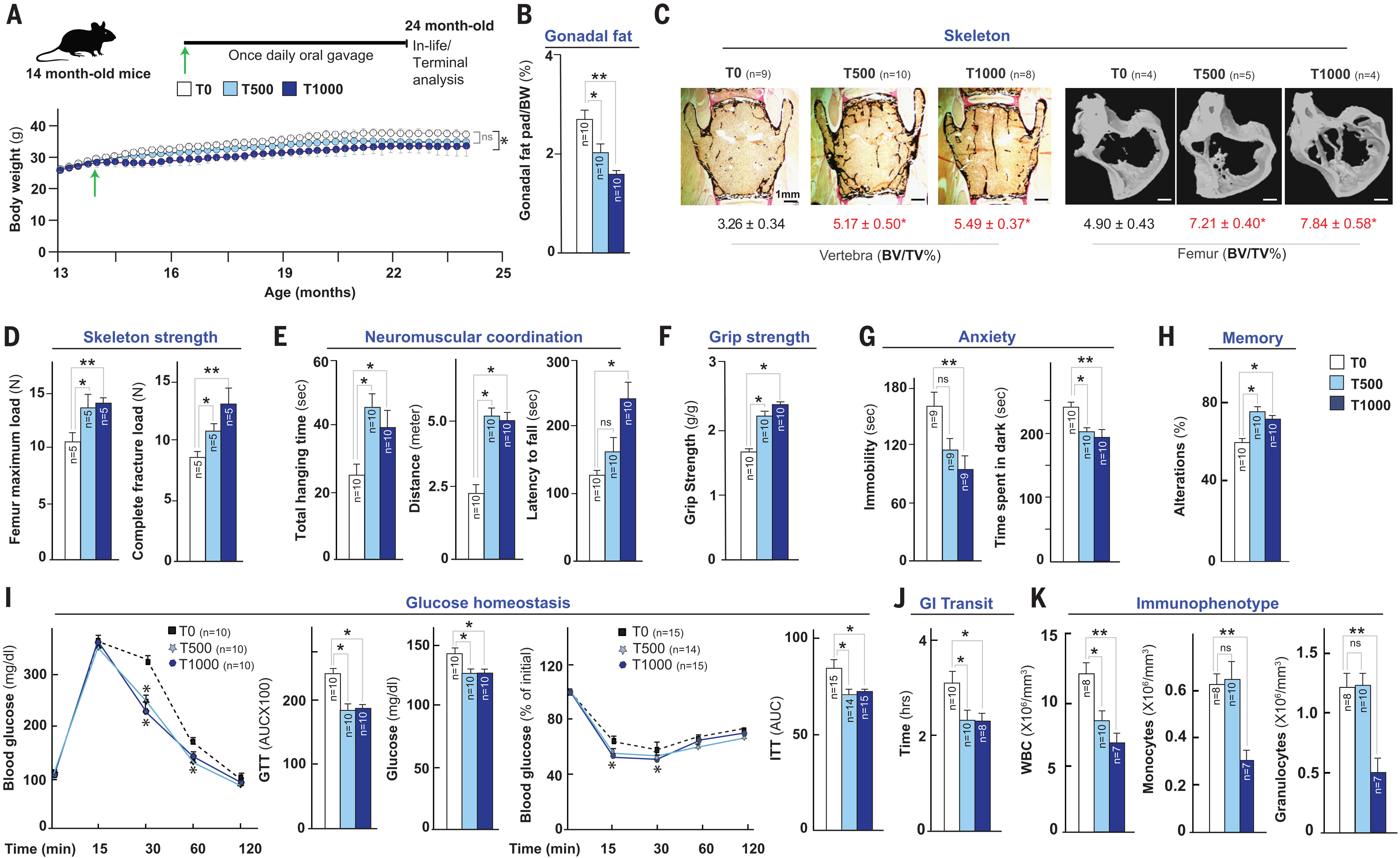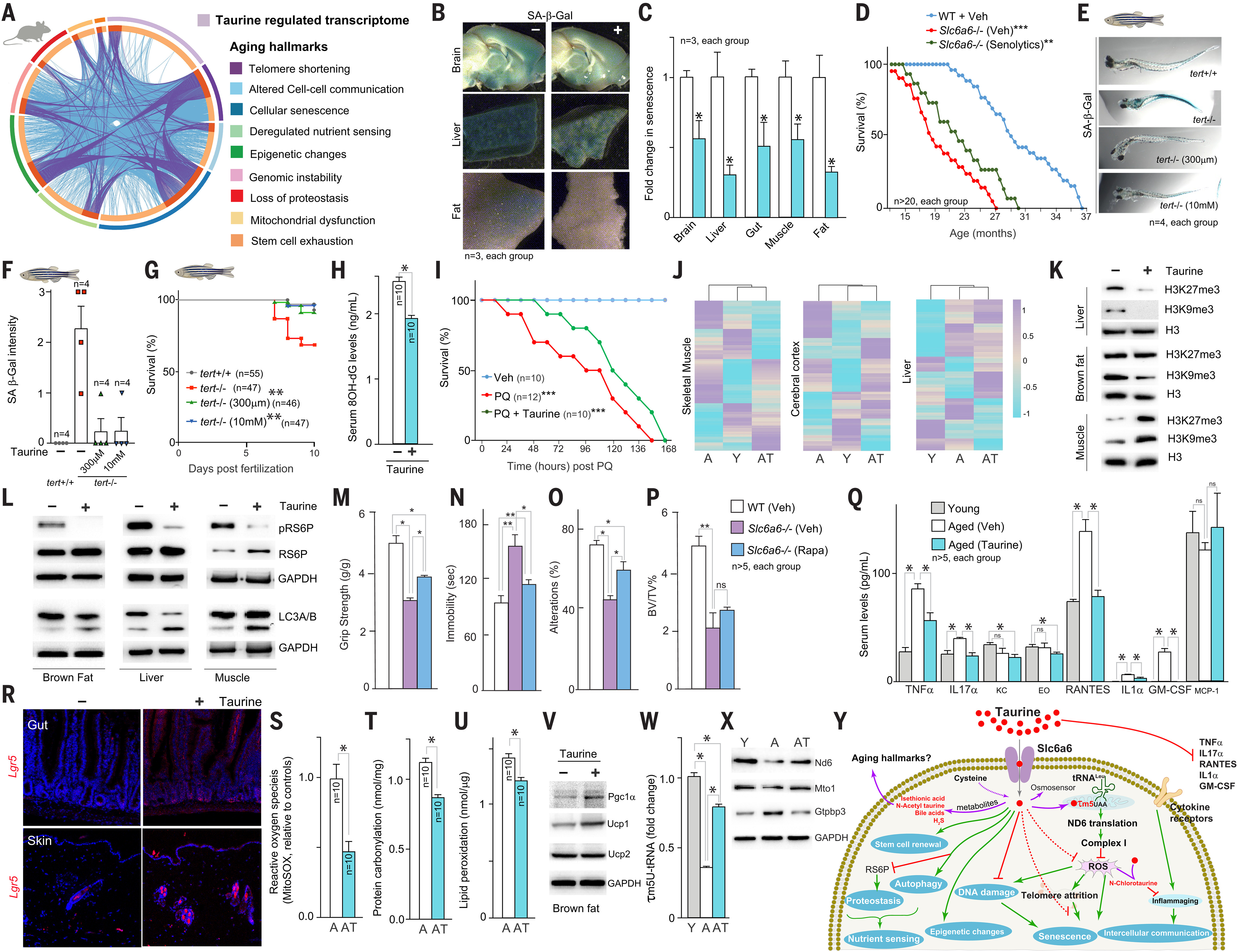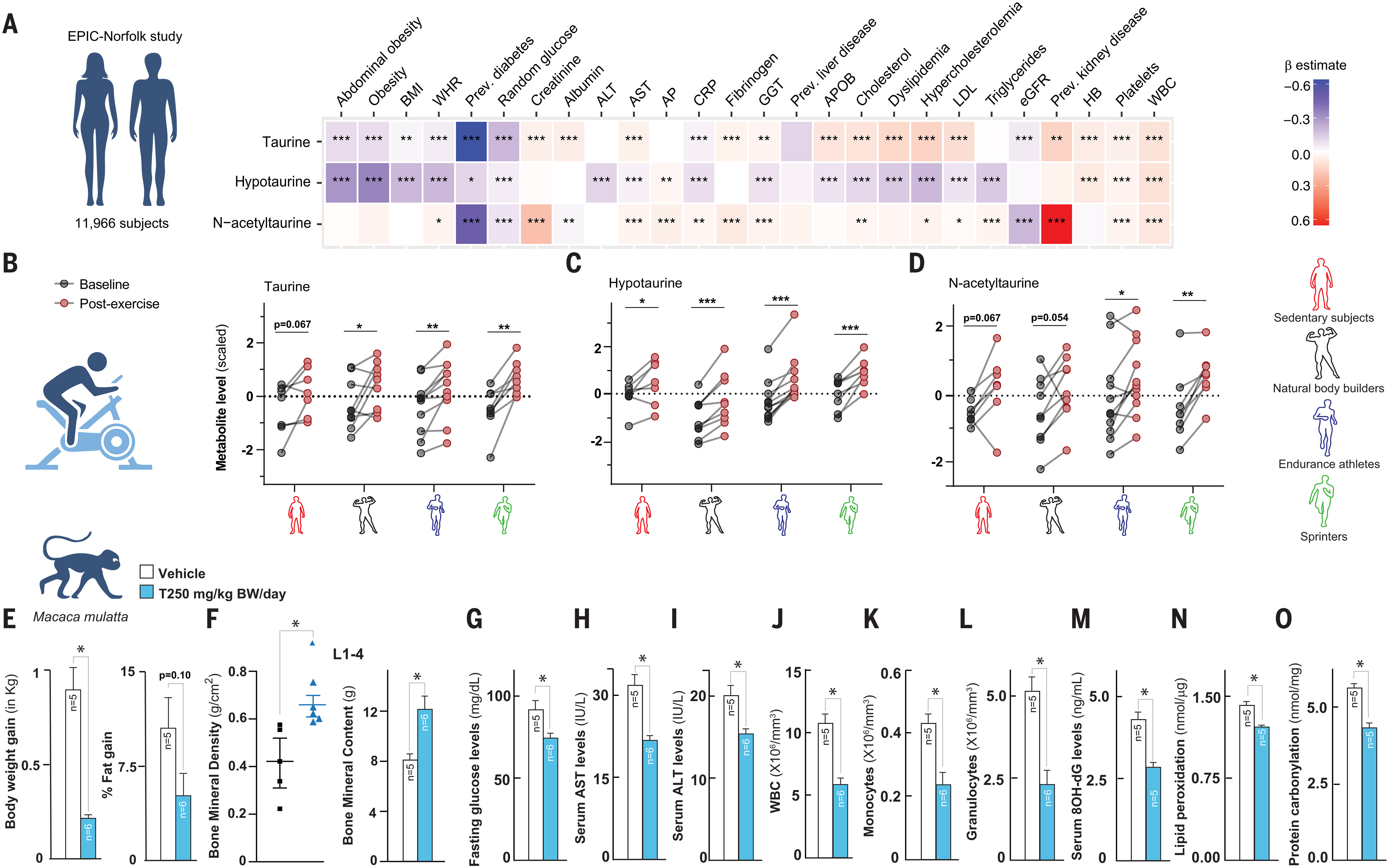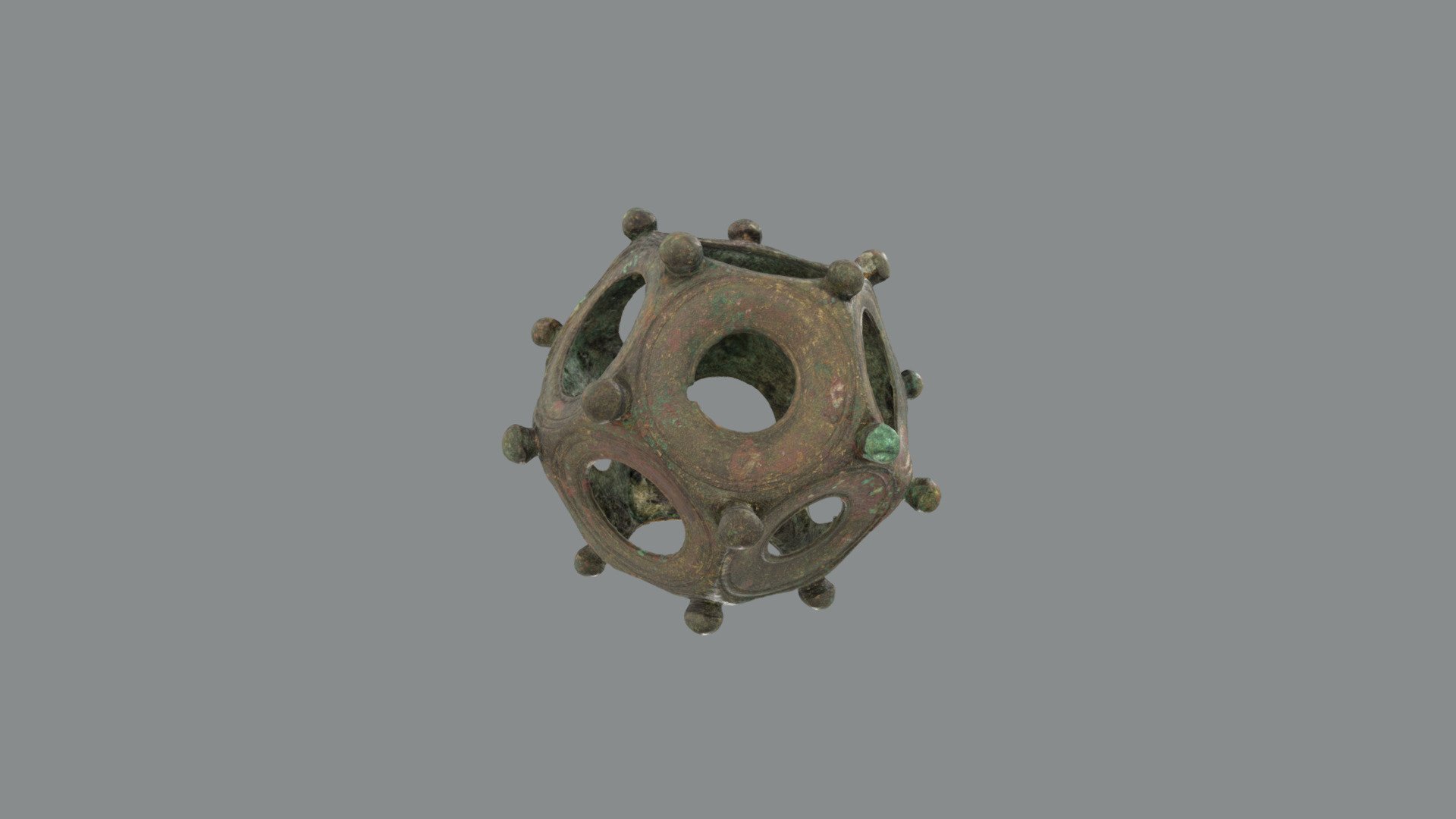Le rapport Borloo :
vivre_ensemble_vivre_en_grand_-_pour_une_reconciliation_nationale
Des éducateurs de l’« Urban sport truck » de l’Addap13 proposent des activités sportives à la cité des Rosiers, à Marseille, en août 2017.
Le rapport Borloo sur les banlieues, remis à Edouard Philippe jeudi 26 avril, compte dix-neuf « programmes » thématiques (rénovation urbaine, éducation, mobilité, sécurité et justice, entreprises et emploi, leadership, égalité et mixité…).
Il est le fruit d’une réflexion et d’un travail menés depuis plusieurs mois avec les élus et les associations de terrain mobilisés au sein du collectif « Territoire gagnants » (à l’initiative de Bleu Blanc Zèbre et Ville et Banlieue).
Depuis janvier, ils ont effectué un « tour de France » afin de faire émerger les solutions les plus innovantes et efficaces déjà en place dans certains quartiers.
Ce rapport propose, entre autres, de démultiplier les meilleures sur tout le territoire. Jean-Louis Borloo recommande également des changements de méthode inédits.
Source : Education, emploi, rénovation… Les propositions-chocs du rapport Borloo
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
Education, emploi, rénovation… Les propositions-chocs du rapport Borloo
Le texte, remis à Edouard Philippe jeudi, compte dix-neuf « programmes » thématiques. Elus et associations ont construit ensemble des solutions.

Le rapport Borloo sur les banlieues, remis à Edouard Philippe jeudi 26 avril, compte dix-neuf « programmes » thématiques (rénovation urbaine, éducation, mobilité, sécurité et justice, entreprises et emploi, leadership, égalité et mixité…). Il est le fruit d’une réflexion et d’un travail menés depuis plusieurs mois avec les élus et les associations de terrain mobilisés au sein du collectif « Territoire gagnants » (à l’initiative de Bleu Blanc Zèbre et Ville et Banlieue).
Depuis janvier, ils ont effectué un « tour de France » afin de faire émerger les solutions les plus innovantes et efficaces déjà en place dans certains quartiers. Ce rapport propose, entre autres, de démultiplier les meilleures sur tout le territoire. Jean-Louis Borloo recommande également des changements de méthode inédits.
- Une académie des leaders, à côté de l’ENA
- Une juridiction pour sanctionner l’inaction
- Trois fronts pour l’emploi
- Rénovation urbaine : des propositions décoiffantes
- Création de « cités éducatives »
- Déploiement de 200 campus numériques
- Aide aux communes pauvres
- Développement de la mobilité
- Promotion de la mixité
- Insertion par le sport
- Jumeler les institutions culturelles avec les QPV
- Une police plus ancrée dans son territoire
- « Une nouvelle armée de la République solidaire »
- Faciliter le financement des associations
- Lutter contre les discriminations
- Jeunesse : « A la rencontre de l’autre »
- Une académie des leaders, à côté de l’ENA
Mesure pour le moins « disruptive » : le rapport Borloo préconise la création, à côté de la prestigieuse Ecole nationale d’administration (ENA), d’une « académie des leaders », qui mènerait elle aussi aux plus hauts postes de la fonction publique. Cette nouvelle grande école permettrait de s’attaquer à l’un des travers de l’ENA régulièrement dénoncé, celui de l’homogénéité de ses diplômés, avec l’entre-soi qui en découle au sein de l’élite de l’Etat. « De fait, nous passons à côté d’extraordinaires talents ou caractéristiques différentes de notre jeunesse et notamment des quartiers populaires », constate l’auteur.
Avec 500 jeunes recrutés par an, sur la base d’un concours très sélectif (une place pour dix candidats), cette académie aurait plusieurs particularités rares dans l’univers des grandes écoles. Comme à l’ENA, les élèves bénéficieraient du statut de fonctionnaire stagiaire, avec 1 700 euros bruts par mois durant leur scolarité, qui s’étalerait sur trois ans. En revanche, la sélection à l’entrée s’opérerait sans aucun diplôme préalable demandé.
Un point devrait faire plus fortement débat : cette voie d’accès aux grands corps de la fonction publique serait réservée, « dans un premier temps, aux jeunes des quartiers prioritaires, s’élargissant par la suite ». Reste la question du coût d’un projet d’une telle ampleur, que Jean-Louis Borloo évalue à 60 millions d’euros par an, « en rythme de croisière ». Une enveloppe conséquente, à l’heure où le monde universitaire ne cesse de dénoncer le manque de moyens dont il souffre.
- Une juridiction pour sanctionner l’inaction des administrations
Afin de s’assurer que les plans de réduction des inégalités territoriales ne soient pas de grandiloquents effets d’annonces, le rapport propose de créer une Cour d’équité territoriale. Cette nouvelle juridiction sera chargée de vérifier la mise en œuvre des moyens de rééquilibrage des politiques publiques sur les territoires carencés.
Cette Cour sera en mesure de condamner les responsables d’administration convaincus de n’avoir pas mis en œuvre avec les moyens adéquats une politique publique décidée au-dessus d’eux mais dont ils ont la charge.
- Trois fronts pour l’emploi
Pour combattre le chômage dans les quartiers relevant de la politique de la ville (QPV), M. Borloo propose d’agir sur trois fronts. D’abord, lancer des plans, très ambitieux, de recrutements dans plusieurs champs, notamment celui des services à la personne. L’objectif est de former et d’orienter vers ce secteur 100 000 personnes issues des QPV, en trois ans. Le ministère des armées est également appelé à la rescousse pour enrôler, chaque année, 5 000 jeunes résidant dans les banlieues populaires.
Autre « acteur » mis à contribution : les entreprises de travail temporaire, invitées à s’impliquer dans une expérimentation qui doit conduire 20 000 habitants des QPV vers l’emploi, en trois ans là encore. M. Borloo préconise de donner plus d’ampleur au dispositif des emplois francs (proposé aux chômeurs dans les zones urbaines sensibles) et d’accroître les obligations d’embauche d’habitants de QPV sur les programmes de grands travaux.
Deuxième axe : encourager le recours à l’apprentissage. « Dans les deux ans », les entreprises privées doivent « parvenir à 1,5 % d’apprentis » domiciliés dans les banlieues populaires. Sinon, « le Parlement sera saisi pour décider de légiférer de manière réellement contraignante ». M. Borloo exhorte aussi le « secteur public » à faire sa part, en recrutant 50 000 apprentis provenant des QPV, en trois ans.
Enfin, il souhaite promouvoir « l’accompagnement et le tutorat » au profit des jeunes, en s’appuyant sur des « réseaux » existants et sur Pôle emploi.
- Rénovation urbaine : des propositions décoiffantes
Ce dont souffre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) actuelle, à l’arrêt de depuis quatre ans, c’est un problème de financement mais surtout de confiance, analyse Jean-Louis Borloo. Il propose tout simplement de créer une fondation et « d’y affecter d’une manière irréversible les fonds et les actifs d’Action logement, garantissant une ressource pérenne ». Cet organisme, ex-1 % logement, collecte chaque année près de 1,7 milliard d’euros auprès des entreprises et autant sous forme de remboursement de prêts consentis aux salariés.
La fondation proposée par M. Borloo « pourra ainsi mobiliser rapidement et puissamment l’ensemble des financements indispensables » et venir au secours des bailleurs sociaux en difficulté. Une proposition qui fera réagir les dirigeants d’Action logement…
Traiter les copropriétés en difficulté est une urgence pour M. Borloo : ce phénomène dramatique touche 120 000 immeubles, dont 100 000 logements de copropriétés en grande difficulté et 20 000 dans une situation irréversible « hors de contrôle » des élus locaux. « Avec les outils actuels, on mettra plus de trente ans à résoudre les problèmes », estime M. Borloo qui appelle à changer de braquet avec un plan massif en cinq ans. Il faut décréter douze sites en Opération de requalification de copropriétés dégradées, sous l’égide de l’Etat, en plus des deux déjà existants, Grigny et Clichy-sous-Bois. Il s’agit de créer une véritable task force de magistrats et commissaires et d’exproprier et racheter 3 000 à 5 000 logements par an, via la Caisse des dépôts, ce qui nécessite 250 millions d’euros par an.
- Création de « cités éducatives »
Le volet scolaire du plan entend remettre l’école et le collège au cœur d’une entreprise globale d’éducation, qui implique des dimensions sociales et culturelles, l’environnement de l’enfant formant un « tout ». Ils formeront une « cité éducative » mettant en réseau tous les acteurs et les lieux qui participent à l’éducation des enfants (centres sociaux, de loisirs, de santé…). Le pilotage de ces cités sera confié au chef d’établissement. L’autonomie de gestion et de budget devra permettre de stabiliser les équipes. Le turnover des enseignants, fléau de l’éducation prioritaire, pourra être régulé par des primes et des avantages décidés à l’échelle de l’établissement. Il s’agit d’une grande nouveauté dans la gestion très centralisée des ressources humaines de l’éducation nationale.
Le plan veut élargir et renforcer les « programmes de réussite éducative », ces réseaux d’acteurs qui prennent en charge de manière « globale » un enfant diagnostiqué à risques en proposant des activités adaptées pendant quelques mois, voire un ou deux ans. Ces programmes sont aujourd’hui sous-dotés et de faible ampleur à l’échelle nationale, puisqu’ils concernent tout au plus 150 000 enfants par an, pour un suivi très court.
- Déploiement de 200 campus numériques
Au programme, le déploiement de 200 campus numériques, dont chacun est défini comme « un vaste lieu (…) permettant au plus grand nombre un accès total, via les outils digitaux les plus innovants, à une offre de services complète et clairement identifiée : formation, emploi, services publics, culture, aide aux juniors, bénévolat. » Avec un investissement initial d’un milliard d’euros – puis 200 millions de fonctionnement par an – ils entendent notamment s’appuyer sur « un vivier de ressource humaine insoupçonnable », les jeunes des quartiers, agiles sur le numérique.
Un des principaux objectifs de ces campus : « Faire exploser le nombre d’étudiants à distance », dans différents domaines, en espérant notamment former davantage de jeunes aux métiers du numérique, où la demande est forte. L’idée est également de proposer sur ces campus des services publics, comme des cabines de télémédecine ou un accompagnement, pour les personnes moins expérimentées, afin de pouvoir utiliser par exemple les sites Web des administrations.
- Aide aux communes pauvres
« Les communes qui ont le plus de besoin ont le moins de moyens en personnel, en accompagnement social et économique, en équipements », constate M. Borloo. Il suggère une péréquation au profit des communes classées en rénovation urbaine qui pourraient ainsi augmenter leur budget de 2 % par an. Serait aussi créé un fonds d’urgence pour les 60 communes les plus pauvres, doté de 500 millions d’euros par an, pour rétablir l’égalité républicaine. M. Borloo invite l’Etat à rembourser aux communes les exonérations de taxe foncière dont bénéficient les bailleurs sociaux, qui pénalisent les municipalités comptant le plus de logements sociaux.
- Développement de la mobilité
Soulignant que les habitants des quartiers « vivent souvent l’enclavement sous toutes ses formes », M. Borloo appelle l’Etat et les collectivités locales à renforcer l’offre de transports à tous les niveaux. Chaque intercommunalité devrait ainsi garantir une offre « équitable » de transports dans son contrat de cohésion urbaine et inclure la desserte des quartiers dans tous les appels d’offres. Et chaque agglomération devrait, en plus de l’offre de transports en commun, établir un plan de mobilité individuelle et douce – covoiturage, location de vélos, aide au permis de conduire…
- Promotion de la mixité
En faveur des femmes, le plan Borloo recommande le financement de 216 « Maisons Marianne » au bas d’immeubles, confiées à des associations promouvant l’égalité, et l’accompagnement de 100 000 femmes vers l’emploi ou la formation professionnelle. 30 000 places en crèches seraient créées et le dispositif des « adultes-relais », sorte de contrats aidés réservés aux plus de 30 ans, relancé.
- Insertion par le sport
Alors que les quartiers prioritaires sont sous-équipés et « comptent deux fois moins de licenciés », le rapport Borloo propose d’y former et recruter 5 000 coachs d’insertion par le sport. Des objectifs annuels chiffrés, en termes de licenciés et d’emplois créés, seraient fixés aux fédérations. 10 000 jeunes seraient formés en vue des Jeux olympiques de 2024.
- Jumeler les institutions culturelles avec les QPV
Dans son chapitre « grandir par la culture », le rapport recommande de « jumeler obligatoirement toutes les institutions culturelles nationales et régionales avec les 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour porter sur tous les champs artistiques » mais aussi d’étendre les projets innovants (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, initié par la Philharmonie de Paris et les Micro-folies de La Villette) à davantage de quartiers et de décliner les chantiers du ministère de la culture (Pass culture, extension des horaires d’ouverture des bibliothèques) en priorité dans les QPV. Enfin, le rapport appelle de ses vœux la création d’un fonds de soutien aux projets artistiques des associations à hauteur de 50 millions d’euros. Au total, le plan Borloo pour la culture en banlieue nécessiterait un budget annuel de plus de 170 millions d’euros.
- Une police plus ancrée dans son territoire
Le rapport Borloo fait le constat de zones devenues des « bases arrière » pour des bandes, des lieux où sévissent des « marchands de sommeil » et où « une petite délinquance par intimidation se développe parfois ». Il plaide à la fois pour une réponse qui favorise la médiation et une police plus ancrée dans son territoire.
Alors que le gouvernement a lancé en février une « police de sécurité du quotidien », censée notamment se déployer dans des quartiers prioritaires, le plan Borloo recommande notamment de fidéliser les policiers « les plus expérimentés » sur place grâce, par exemple, à une rémunération attractive.
Le rapport recommande aussi de financer dans les villes les plus pauvres l’équipement en vidéosurveillance et la création de polices municipales. Il préconise enfin le recrutement de 500 « correspondants de nuit » sous des postes « d’adulte-relais » qui seraient autant de moyens de mailler plus finement le territoire et d’œuvrer à la tranquillité publique.
- « Une nouvelle armée de la République solidaire »
Il s’agit des 35 000 professionnels de l’action sociale dans les quartiers de la politique de la ville. Il est notamment proposé de revaloriser leur rôle et leur statut, et de supprimer la mécanique des appels à projets qui les obligent à courir après les financements au lieu de se consacrer à leur métier d’origine.
- Faciliter le financement des associations
Les quartiers comptent 100 000 associations et un million de bénévoles qui « pallient souvent la faiblesse des pouvoirs publics », souligne le rapport, qui préconise un « renversement total de perspective » en mettant un terme à la logique des appels à projets. L’objectif : faciliter leur financement afin qu’elles puissent œuvrer dans la durée.
- Lutter contre les discriminations
En plus des autres programmes (emploi, justice…) destinés à lutter contre les discriminations, le rapport propose de renforcer un certain nombre de mesures existantes comme la multiplication des testings, l’accompagnement de plans territoriaux de lutte, le financement de campagnes de sensibilisation…
- Jeunesse : « A la rencontre de l’autre »
Il s’agirait notamment du nom d’un projet national citoyen dédié à la jeunesse qui mettrait l’accent sur les voyages scolaires et extrascolaires – 50 % des enfants des familles les plus modestes ne partent pas en vacances.